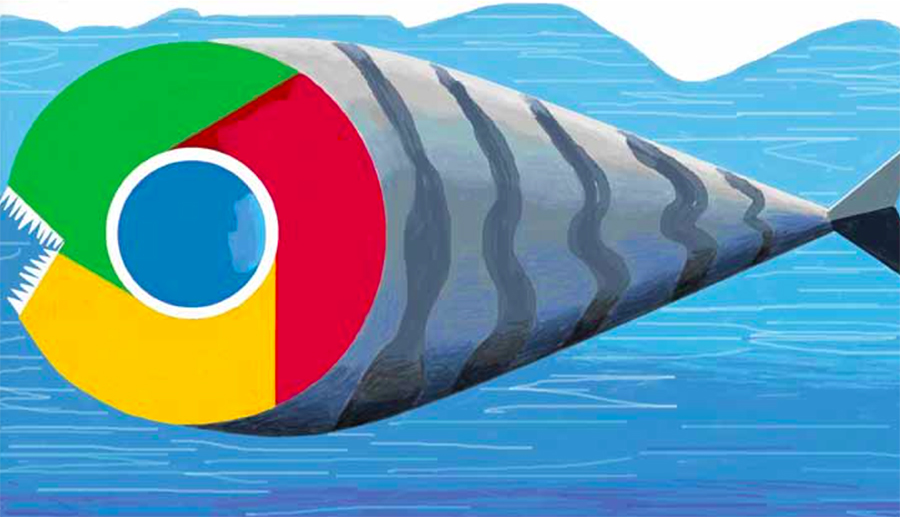Des barbares se déploient dans les villes, dans les campagnes, dans nos maisons, dans nos téléphones, dans nos montres, dans nos brosses à dent. Ils prennent souvent l’apparence de nos cousins d’Amérique et maintenant celle de nos plus proches voisins. Les barbares sont à nos portes, les barbares sont en nous, les barbares, les barbares…
Dans un brillant essai, Alessandro Baricco énumère les ravages visibles du passage de ceux qu’ils nomment Les Barbares dans des domaines aussi différents que le livre, la musique classique, le foot ou le vin. Il cherche à comprendre leur stratégie, à esquisser leur portrait. Il finit par en saisir un au vol : l’animal Google. Tel un pisteur, il suit ses traces, et ce faisant, il rend visible la mutation en cours, celle qui est portée par ces nouvelles invasions barbares. Ces invasions ébranlent des principes fondateurs hérités de la société industrielle et de l’esprit des Lumières. Cela ressemble fortement à un clivage entre l’ancienne Europe bourgeoise et érudite qui s’est fourvoyée dans l’horreur des guerres et l’Amérique décomplexée, avide de liberté et de reconnaissance, qui nous a sauvés d’une noyade nauséabonde. L’Europe élitiste contre l’Amérique pour tous, l’ancien monde contre le nouveau. Cette dualité, certes très réductrice et, on peut le penser, largement dépassée aujourd’hui, n’en est pas moins structurante. Nos vieux réflexes européens nous portent à juger sans cesse les coups d’éclats outre-Atlantique comme une agression, déclenchant mécaniquement une position défensive. Or, il va bien falloir que nous acceptions que le monde a changé, ou plutôt que le monde s’est invité chez nous. Nos outils (institutions, langues, systèmes de pensée, etc.) se montrent de plus en plus inefficaces, car comme nous l’explique Alessandro Baricco : « D’habitude on se bat pour contrôler des points stratégiques sur la carte. Aujourd’hui, les agresseurs font quelque chose de plus radical : ils sont en train de redessiner la carte ». Il est temps de comprendre les nouvelles règles du jeu. Cela ne signifie pas perdre son identité, mais la construire dans un univers plus vaste. « Nous sommes tous au même point, dans le seul lieu qui soit et dans le courant de la mutation, où nous appelons civilisation ce que nous connaissons, et barbarie ce qui n’a pas encore de nom. Et contrairement à d’autres, je pense que c’est un lieu magnifique », conclut l’auteur.
Qu’est-ce qui définit ces nouveaux barbares et, donc, notre future civilisation ? Pour le comprendre, il est utile de se référer à ce que nous tenons pour acquis et de mesurer la différence. Par exemple, apprendre à l’école, maîtriser un sujet, travailler, toutes ces activités nous les associons au labeur, à l’effort, parfois au sacrifice de soi. Nous pouvons passer notre vie entière à approfondir un sujet ultrapointu qui ne sera peut-être jamais lu. Pour citer un film populaire français, nous sommes du genre à faire une thèse sur « les chevaliers paysans de l’an mil au lac de Paladru ». Effort et profondeur sont deux valeurs essentielles, arrimées solidement en nous, depuis l’école primaire. Pourtant qu’en est-il réellement de nos pratiques, de nos aspirations ? Aujourd’hui, nous surfons sur le Web, passant d’un bout de savoir à un autre, les associant dans une trajectoire chaotique et arbitraire. Nous cherchons à faire émerger du sens de ce zapping éclectique permanent, de ce mouvement en surface des choses. Tout cela est ludique, mais c’est aussi une nouvelle façon d’apprendre. Les entreprises du numérique ont toutes installé des salles de jeux dans leurs bureaux (PlayStation, flipper, ping-pong…). Plus on s’amuse en travaillant, plus on sera performant, voilà ce que martèlent les adeptes du bonheur au bureau. Ce mouvement n’est pas juste un effet de mode, mais une tentative de redéfinir le travail : il est question d’activité, de réalisation de soi, d’empowerment. Ces nouvelles conceptions du travail et de l’acquisition de la connaissance entrent en totale contradiction avec nos vieilles convictions. Pourtant, il faut reconnaître que, dans la pratique, nous avons déjà adopté ce mode de faire. Certes, nous rechignons encore à l’accepter comme un mode de pensée respectable. Cela viendra. En effet, la philosophie de l’effort et de la profondeur n’est pas inscrite dans notre ADN, elle a été construite pas à pas au XVIIIe puis au XIXe siècle…
Une autre caractéristique vient nous heurter de plein fouet : le rapport au passé qu’entretiennent les barbares. Pour la vieille Europe, le passé est un trésor enfoui, qu’il convient de déterrer, de préserver, de restaurer dans les règles de l’art. Nous nous construisons en référence à ce passé, dans la perspective d’une continuité, d’une amélioration. Les barbares, eux, ne s’intéressent au passé que s’il a une utilité immédiate pour le présent. Ils n’ont pas de rapport sacré au passé. Pour Uber ou Amazon, s’attaquer à des pratiques, des savoir-faire, des lieux qui se sont construits génération après génération n’a aucune importance, ce qui compte c’est ce qu’il est possible de faire de neuf avec des morceaux de vieux, ce qu’il est possible de faire différemment. Alessandro Baricco désigne élégamment cette attitude de saccage du passé par « le pas de côté ». Les barbares ne s’inscrivent pas dans une continuité, ils vivent dans une économie de la rupture, ils redessinent la carte continuellement.
Un autre trait communs aux barbares c’est de s’ouvrir au plus grand nombre, rendre accessible à tous, quitte à perdre en profondeur et à s’étendre comme une pieuvre. Google l’incarne à merveille : numérisation des livres ou des œuvres d’arts, mais aussi gratuité des services : moteur de recherche, mail, système d’exploitation, Google Maps, Google Earth ou encore Ingress. L’entreprise de Mountain View englobe progressivement notre quotidien, devient notre porte d’accès au monde, comme une seconde peau. Le modèle gratuit est à la fois un moteur de démocratisation mais aussi une indication d’un glissement progressif de la valeur vers la périphérie. En effet, cette dernière se trouve de moins en moins dans le produit et de plus en plus dans le volume des interactions que ce produit aura généré (conversations, partages, expériences, produits dérivés). Ce principe de la valeur en périphérie est un élément fondamental de la mutation économique en cours. Il est d’ailleurs à l’œuvre depuis quelques temps dans le domaine culturel par exemple. Le modèle économique des salles de cinéma s’appuie sur les ventes de pop-corn plutôt que sur celles des billets. On valorise plus l’expérience du cinéma que le film en soi. C’est une dévalorisation de l’objet artistique, une véritable barbarie. Alessandro Baricco questionne cette désacralisation à plusieurs reprises. Il se demande d’abord si notre résistance n’est pas un signe d’élitisme, un refus de démocratiser un peu plus la connaissance. Il prend l’exemple de l’arrivée du roman au XIXe siècle et de la symphonie en musique classique. Dans les deux cas, ce fut un choc pour les intellectuels d’alors, un véritable scandale, un affaiblissement de la culture, mû par une logique commerciale dégradante, celle de vendre des livres à des non-érudits, à la populace de l’époque. Aujourd’hui, les romans font figure d’objet d’art en comparaison des livres confessions de stars de la télé-réalité. De même la musique classique, dans sa dimension lyrique et symphonique (en opposition à la musique baroque, de chambre…), s’est imposée comme un art majeur. Cette nouvelle barbarie ne serait donc qu’une remise en cause de l’académisme, qu’une destitution des anciens par les nouveaux, un cycle habituel, finalement ? Au-delà de ce conflit de génération, l’auteur perçoit néanmoins une dynamique continue d’élargissement du public et de l’offre, une nouvelle étape dans la démocratisation de la culture et des médias. Le succès commercial du livre de Valérie Trierweiler n’a en rien entamé les ventes des grands classiques de la littérature. Mieux, il n’y a jamais eu autant de lecteurs de Voltaire ou de Victor Hugo. Il utilise la métaphore du jaune d’œuf pour l’illustrer : le jaune représente les œuvres de littérature, le blanc toutes les productions en tête de gondole. À bien y regarder, le jaune est intact, c’est le blanc qui s’est développé. Ainsi la démocratisation du livre n’a pas tué les auteurs, au sens artistique du terme. S’il y a eu une contamination du jaune par le blanc, elle l’a été dans la forme : réédition de livres à l’origine de films à succès, format économique, illustré, audio… Et elle n’a pas mis en danger l’intégrité des œuvres et des auteurs. Alessandro Baricco nous rappelle également que la logique du profit n’a rien de nouveau : « Tout ce que nous considérons aujourd’hui comme un art élevé, à l’abri de la corruption marchande, est né pour satisfaire la totalité de son public, en toute cohérence avec une logique commerciale que les considérations artistiques freinaient peu. (…) Même si, par avidité commerciale, on a parfois pu donner aux gens le pire, ce système-là n’a empêché la naissance d’aucun Verdi ».
Les barbares ne seraient alors que l’expression d’une version plus démocratique de notre société et, en tant qu’anciens privilégiés, nous nous sentirions menacés par les hordes populaires et leurs mauvaises manières. Il y a sans doute une part de vérité dans cette analyse. Néanmoins, si l’on se concentre sur les entreprises numériques, ces nouveaux entrants, aujourd’hui stars des bourses, se rapprochent plus d’une nouvelle classe dominante, que de l’image d’un Robin des bois. Casser les sphères de pouvoir et les barrières à l’entrée, favoriser l’auto-organisation des individus et la quête d’autonomie par le partage de la connaissance, le mouvement s’inscrit clairement dans un idéal démocratique et dans une volonté affichée de changer le monde en mieux : lutte contre la pollution, les inégalités, la pauvreté, la maladie, la mort. Mais un des résultats observés est celui d’une concentration des richesses au sein de quelques plates-formes numériques, devenues des pieuvres mondiales et de plus en plus automatisées. Et nous, nous devenons tous des contributeurs de ces plates-formes et sommes de moins en moins rémunérés pour nos actions. Revenons sur l’idée de la valeur en périphérie, dans les interactions, et bien cela s’applique aussi à l’individu. L’individu n’a plus de valeur en lui-même, ce qui a de la valeur c’est sa façon d’entrer en mouvement avec les autres et avec son environnement. Le big data illustre cette translation, puisqu’il s’attache à modéliser les trajectoires de nos vies, plus que notre essence individuelle. Ce qui compte, ce n’est pas qui on est, mais comment on entre en connexion avec le monde. Les données et le traitement algorithmique nous rendent visibles à partir de nos traces, un peu comme les caméras infrarouges dessinent nos silhouettes en calculant les variations de température, ce qui compte c’est la différence (le pas de côté). Et là où le bât blesse, c’est que le moteur de redistribution de ces nouvelles richesses reste à inventer. Une économie des plates-firmes, c’est à dire des plates-formes numériques industrielles, prend progressivement l‘ascendant sur l’ancienne économie verticale et sectorisée. Les sociétés plates-formes comme Google ou Facebook, sont des outils génériques, des agrégateurs horizontaux, sans limite visible, où tout est à un clic, sans cohérence apparente (surface plus que profondeur). L’activité de Google s’étend de la gestion d’outils de communication à la production d’énergie, de moyens de transport, de robots, jusqu’à la recherche génétique et biologique. Vers l’infini et au-delà.
Qui sont donc finalement ces nouveaux barbares ? Des créatures parfaitement en adéquation avec leur temps. Issus de la culture de l’hypertexte et du zapping, leur fonctionnement est horizontal et délinéarisé, ils surfent à la surface du Web, toujours en mouvement, évitant de plonger trop profondément, ignorant les frontières, créant de nouveaux liens. Ils apportent un soin particulier au design de leur service, il faut que ce soit simple, esthétique, ludique et rapide. Nous rendre partisan du moindre effort, c’est la raison d’être du cloud (on ne se préoccupe plus des sauvegardes, on passe d’un écran à l’autre sans couture), mais aussi de la suggestion de mots clés au cours de la frappe dans les moteurs de recherche (quitte à influencer nos requêtes), ou encore des cookies qui nous reconnaissent (et nous exposent à des publicités ciblées), de la géolocalisation qui adapte le contenu au contexte (et nous piste en permanence). La technologie devient invisible, presque magique. En contrepartie nous faisons une confiance aveugle aux barbares, en leur étant totalement transparents. Et c’est là, le point critique, car dans ce nouveau monde, les règles économiques ont changé, la valeur s’est déplacée en périphérie et ce ne sont plus les producteurs et les créateurs qui la concentrent, mais les plates-formes d’intermédiation et de productivité (les logiciels). Et, pour le moment, le moteur de redistribution des richesses n’a pas pris en compte cette évolution. En outre, ces plates-formes, pour réussir, ont besoin d’atteindre une masse critique très élevée (plus d’un milliard d’utilisateurs actifs sur Facebook ou YouTube, par exemple). Cela provoque une forte concentration de l’activité et tend à déstructurer brutalement des secteurs économiques en place (disparition d’acteurs, domination du marché, lobby réglementaire…). Néanmoins, la perpétuelle recherche d’innovation disruptive, le pas de côté, comme dit Alessandro Baricco, entretient une instabilité économique et une compétition de tous les instants. « La roche tarpéienne est proche du Capitol », un jour au sommet, le lendemain jeté aux lions, à l’image de la société RIM avec ses BlackBerry. La dernière dimension barbare notable est cette volonté affichée de résoudre les problèmes du monde, comme la pauvreté, la maladie ou la pollution, elle fait partie intégrante de leur vision d’entreprise et structure leur activité. Certains contradicteurs, comme Evgeny Morozov n’ont pas manqué de dénoncer cette forme de solutionnisme naïf, contreproductif et parfois parfaitement cynique.
En définitive, la nouvelle civilisation qui émerge de ces invasions barbares, nous est déjà familière. Nous vivons dans le tumulte de cette mutation et changeons un peu plus chaque jour. Nous devenons poisson, pour reprendre la métaphore d’Alessandro Baricco, plus ça va, plus nous respirons à l’aide de nos branchies. Mais il va falloir sérieusement penser à nous organiser collectivement au sein des océans, au risque d’être maintenus dans les profondeurs par quelques gros prédateurs qui ne cherchaient au départ qu’à en faire le meilleur endroit sur terre.
Chrystèle Bazin
Pour en savoir plus
Alessandro Baricco, Les Barbares : essai sur la mutation, éditions Gallimard, 2014.
Evgeny Morozov, Pour tout résoudre, cliquez ici : l’aberration du solutionnisme technologique, éditions FYP, 2014
Alain Busson et Chrystèle Bazin, La vie, les médias et le reste, éditions Udecam, 2015.
Article publié dans Office et Culture, juin 2015, n°36